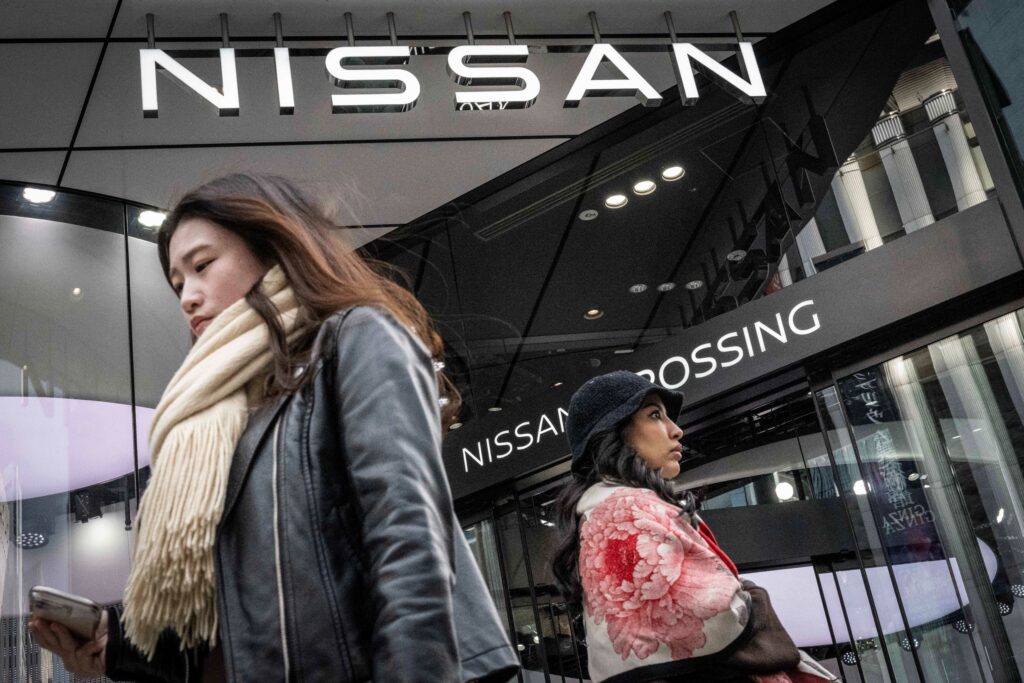AFP Business
Taxes sur les billets d’avion: Ryanair quitte Bergerac, Brive et Strasbourg
En guerre contre la taxe de solidarité sur les billets d’avion, la compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé mercredi une réduction de 13% de sa capacité en France pour l’hiver 2025, soit 750.000 sièges en moins, l’annulation de 25 lignes et l’interruption de la desserte de trois aéroports.La première compagnie à bas coûts européenne a notamment annoncé “l’arrêt de ses opérations” aux aéroports de Bergerac (Dordogne), Brive (Corrèze) et Strasbourg (Bas-Rhin), d’où elle desservait le Portugal ou l’Ecosse. La compagnie avait déjà quitté Vatry (Marne) au printemps.”Cette décision fait suite à l’échec du gouvernement français à annuler l’augmentation excessive de la taxe aérienne, qui a été augmentée de 180% en mars 2025″, a expliqué dans un communiqué la compagnie aérienne irlandaise.La taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) est passée à 7,4 euros contre 2,63 euros auparavant pour les vols intérieurs ou vers l’Europe.”Cette taxe astronomique rend la France moins compétitive par rapport à d’autres pays de l’UE comme l’Irlande, l’Espagne ou la Pologne, qui n’imposent aucune taxe aérienne”, a poursuivi Ryanair.La compagnie avait menacé de réduire ses opérations en France depuis le triplement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion appliquée dans le budget 2025. Le patron de la compagnie Michael O’Leary avait cependant assuré fin mars qu’il ne couperait pas de desserte régionale.La compagnie s’est aussi fait menaçante pour l’été 2026. “Sans action urgente, la France risque de perdre encore plus de capacité et d’investissements au profit de marchés plus compétitifs à l’horizon de l’été 2026, laissant les aéroports régionaux à moitié vides, tandis que d’autres pays de l’UE continueront d’attirer les investissements des compagnies aériennes, devenus rares en raison de la pénurie d’avions”, a-t-elle souligné. Au contraire, si le gouvernement décidait de supprimer complètement cette taxe, Ryanair pourrait “envisager une croissance ambitieuse en France dans les années à venir, incluant un investissement de 2,5 milliards de dollars (25 nouveaux avions) et un doublement du trafic à plus de 30 millions de passagers par an.L’Union des aéroports français (UAF) avait mis en garde contre le risque de voir les compagnies aériennes à bas coûts, qui pèsent plus de 99% de l’activité de Beauvais, Carcassonne, Béziers et Nîmes, se détourner de la France en raison de l’augmentation de cette taxe.
IA: Google signe le code de conduite de l’UE, contrairement à Meta
Google a annoncé mercredi signer le code de conduite de l’Union européenne sur l’encadrement des modèles d’intelligence artificielle (IA), contrairement à Meta.”Nous allons rejoindre plusieurs autres entreprises (…) en signant le code de conduite de l’Union européenne sur l’IA à usage général”, a indiqué Kent Walker, président des affaires mondiales de Google.OpenAI, créateur de ChatGPT, et la start-up française Mistral ont déjà annoncé signer ce code de conduite, tandis que Meta (Facebook, Instagram…) — virulent détracteur des règles numériques européennes — a affirmé qu’elle ne le ferait pas.Publiées le 10 juillet, ces recommandations européennes sur les modèles d’IA les plus avancés, comme ChatGPT, mettent notamment l’accent sur les questions de droits d’auteur. L’UE appelle à exclure de l’IA les sites connus pour des actes répétés de piratage et demande aux signataires de s’engager à vérifier que leurs modèles ne reprennent pas des propos injurieux ou violents.Ces recommandations sont pensées pour les modèles d’IA à usage général, comme ChatGPT, Grok de la plateforme X ou Gemini de Google. Grok a récemment défrayé la chronique en relayant des propos extrémistes et injurieux. La start-up d’Elon Musk xAI, responsable de Grok, avait présenté ses excuses pour le “comportement horrible” de son robot conversationnel.Ce “code de bonnes pratiques” n’est pas contraignant. Les entreprises signataires bénéficieront toutefois d’une “charge administrative réduite” quand il s’agira de prouver qu’elles se conforment bien à la législation européenne sur l’IA, promet la Commission européenne.Cette future règlementation, baptisée “IA Act”, suscite les foudres des géants de la tech, qui ne cessent d’appeler à reporter la loi.Mercredi, Google a encore affirmé que les règles européennes “risquent de ralentir le développement de l’IA en Europe”.La Commission maintient son calendrier, avec une mise en place à partir du 2 août et le gros des obligations en vigueur un an plus tard. L’exécutif européen dit vouloir limiter les dérives de l’IA tout en évitant de brider l’innovation. C’est pourquoi il classifie les systèmes selon leur niveau de risque, avec des contraintes proportionnelles au danger.Les applications à haut risque, utilisées par exemple dans les infrastructures critiques, l’éducation, les ressources humaines ou le maintien de l’ordre, seront soumises, d’ici à 2026, à des exigences renforcées avant toute autorisation de mise sur le marché en Europe.
Zone euro: la croissance du PIB a atteint 0,1% au deuxième trimestre
La croissance économique de la zone euro a atteint +0,1% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon la première estimation publiée mercredi par l’office européen de statistiques Eurostat.Le consensus des analystes tablait sur une stagnation, au moment où les 20 pays partageant la monnaie unique connaissent des performances inégales.La France et l’Espagne ont enregistré des chiffres meilleurs que prévu, alors que l’Allemagne déplore un recul surprise sur la période avril-juin.Au premier trimestre, la croissance dans la zone euro avait atteint +0,6%, ce qui s’expliquait par une performance surprise de l’Irlande.Dans l’ensemble de l’UE, le Produit intérieur brut a progressé de 0,2% sur avril-juin, après +0,5% lors du trimestre précédent, précise Eurostat.Parmi les pays qui ont tiré les chiffres vers le haut au deuxième trimestre figurent au premier rang l’Espagne (+0,7%), puis le Portugal (+0,6%) et l’Estonie (+0,5%). Cette fois un recul a été enregistré en Irlande (-1,0%), tandis que l’Allemagne et l’Italie déplorent chacune -0,1%.Pour l’Allemagne, première économie européenne, le recul est dû à la baisse des investissements, notamment dans la construction, malgré un rebond de la consommation des ménages jusqu’ici morose.Les chiffres allemands du jour rompent avec le rebond de croissance enregistré en début d’année (+0,3% selon un chiffre révisé mercredi).
Nissan lourdement déficitaire au 1T, ventes en berne et surtaxes américaines pèsent
Le constructeur automobile japonais en difficulté Nissan a annoncé mercredi avoir enregistré sur le trimestre d’avril à juin une perte nette de 116 milliards de yens (680 millions d’euros), sur fond de ventes en berne et d’impact des surtaxes douanières américaines.Au premier trimestre de son exercice décalé, entamé en avril, Nissan a vu son chiffre d’affaires fondre de presque 10% sur un an, à 2.707 milliards de yens (15,8 milliards d’euros) avec un repli de 13% en Amérique du Nord. La perte nette enregistrée est moindre qu’attendu par les analystes sondés par Bloomberg, mais reflète une situation toujours morose pour le constructeur nippon, engagé dans une douloureuse restructuration.Si des réductions de coûts fixes “ont permis d’atténuer les pertes, le groupe continue de faire face à des vents contraires: baisse des volumes de ventes, fluctuations défavorables des taux de change et impact des taxes douanières américaines”, note le groupe.Nissan, dont le français Renault détient 35%, maintient ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2025-2026, à 12.500 milliards de yens (73 milliards d’euros), mais renonce à fournir des anticipations de bénéfice annuel dans un environnement commercial toujours volatil.Les exportations automobiles du Japon vers les Etats-Unis sont surtaxées à 25% depuis avril par l’administration Trump. Les droits de douane totaux devraient être ramené à 15% selon l’accord récemment conclu entre Tokyo et Washington.Dans ce contexte, Nissan a vu ses ventes aux Etats-Unis, en nombre d’unités, reculer de 6,5% sur un an en avril-juin.Mais ses ventes en termes de véhicules écoulés sont aussi en forte baisse au Japon (-11,1%) et en Chine (-27,5%), son marché phare où il affronte la concurrence acérée des constructeurs locaux, notamment sur l’électrique.-“Urgence”-Les tensions commerciales interviennent alors que Nissan était déjà très fragilisé. Après une tentative avortée de mariage avec son compatriote Honda, il a dévoilé une perte nette annuelle colossale équivalant à 4,1 milliards d’euros sur son exercice décalé 2024-2025.Et ce, notamment en raison des coûts liés au plan de redressement engagé par l’entreprise.Non rentable et miné par l’essoufflement des ventes, Nissan entend réduire le nombre de ses usines de production de véhicules de 17 à 10 d’ici la fin de l’exercice 2027, pour ramener à 2,5 millions de véhicules par an, contre 3,5 actuellement, ses capacités de production hors de Chine.Le groupe nippon vise aussi 20.000 suppressions de postes dans le monde à la même date.Nissan a récemment indiqué qu’il arrêtera début 2028 sa production dans son usine d’Oppama (sud de Tokyo), qui emploie quelque 2.400 personnes. Et il a annoncé mercredi transférer la production de son usine mexicaine de Civac vers son complexe d’Aguascalientes, également au Mexique, d’ici la fin de l’exercice en cours.”Ces résultats trimestriels rappellent l’urgence de notre plan de relance. Au cours du dernier trimestre, nous avons pris des mesures décisives (…) Nous devons maintenant aller plus loin et plus vite pour atteindre la rentabilité”, a commenté mercredi le PDG Ivan Espinosa, nommé fin 2024 pour mettre en oeuvre la restructuration du groupe.Dans l’immédiat, ces mesures de redressement s’annoncent douloureuses: Nissan a enregistré une perte d’exploitation de 79,1 milliards de yens (462 millions d’euros) au premier trimestre, et il en anticipe une de 100 milliards de yens pour le deuxième trimestre (juillet-septembre).Pour l’ensemble de l’année, les analystes tablent sur une perte d’exploitation abyssale de 234 milliards de yens (1,4 milliard d’euros).Petite embellie: Nissan a réussi en juillet à lever 4,5 milliards de dollars via une émission obligataire couronnée de succès.”Les investisseurs étrangers ont le sentiment que le secteur automobile japonais bénéficie du soutien du gouvernement et que Nissan, lui aussi, sera finalement soutenu”, observait alors déclaré Haruyasu Kato, gestionnaire de fonds chez Asset Management One, cité par Bloomberg.Reste la question des barrières douanières imposées par Washington.Nissan “n’est tout simplement pas en capacité d’absorber les surcoûts” entraînés par les droits de douane, mais “comme il a des surcapacité aux Etats-Unis, il est relativement mieux placé” que ses compatriotes Honda et Toyota “pour y augmenter sa production”, indique à l’AFP Satoru Aoyama, de Fitch Ratings.Mais il devra repenser son offre, insiste-t-il “Nissan n’a pas encore d’hybride en Amérique du Nord, alors que ce créneau y est en plein boom. C’est une erreur d’appréciation du marché”.
Déception pour le PIB allemand, qui recule au deuxième trimestre
L’économie allemande a replongé au deuxième trimestre après une hausse du PIB en début d’année, selon une première estimation publiée mercredi, un mauvais signe pour le pays qui espère se sortir de deux années de récession consécutives.Entre avril et juin, le Produit intérieur brut allemand a reculé de 0,1% selon l’institut Destatis, tandis que les analystes de la plateforme Factset et de la Bundesbank s’attendaient à une stagnation.La première économie européenne a souffert de la baisse des investissements, notamment dans la construction, malgré un rebond de la consommation des ménages jusqu’ici morose.Les chiffres du jour rompent avec le rebond de croissance enregistré en début d’année, revu à la baisse mercredi de 0,4% à 0,3%. Les effets d’anticipation des droits de douane américains, qui avaient dopé l’activité au premier trimestre, semblent avoir disparu.Ainsi, le PIB allemand, apathique depuis plusieurs années en raison d’une crise industrielle et de son modèle exportateur, retrouve de facto son niveau pré-Covid, selon le cabinet Capital Economics. “Après quelques bons chiffres, c’est donc à nouveau une déception pour l’économie allemande”, estime Jens-Oliver Niklasch de la banque LBBW.Il ajoute que les barrières commerciales érigées par les Etats-Unis, premier partenaire commercial de l’Allemagne, “ont probablement fait des ravages”, bien que la première estimation de Destatis ne soit pas explicite.”Cela ne signifie pas pour autant que la reprise soit compromise”, nuance Geraldine Dany-Knedlik de l’institut DIW.Elle relève une embellie du climat des affaires et de la production dans le secteur manufacturier, tandis que l’accord entre Bruxelles et Washington apportera une “plus grande sécurité de planification”.L’UE et les Etats-Unis se sont mis d’accord sur des droits de douane de 15% sur les importations européennes, avec des exemptions à venir pour certains secteurs.Ces surtaxes causeront des “dommages importants” à l’économie allemande très dépendante des exportations, a reconnu lundi le chancelier Friedrich MerzMardi, le Fonds Monétaire international a indiqué s’attendre à une hausse du PIB de 0,1% en Allemagne, contre une stagnation auparavant, estimant que l’économie mondiale résistera mieux que prévu aux conflits commerciaux.Mais cette prévision ne tient pas en compte l’accord douanier de la semaine dernière, de même que celle du gouvernement allemand qui table sur une stagnation de l’économie en 2025.La crise de l’industrie allemande, entre prix de l’énergie élevé et perte de terrain face aux concurrents chinois est un défi majeur pour le gouvernement de Friedrich Merz, entré en fonction début mai.Le chancelier compte sur un effort budgétaire conséquent pour relancer l’économie, avec une enveloppe de plusieurs centaines de milliards d’euros destinée à moderniser la défense et les infrastructures, dont les effets devraient se faire sentir sur la croissance en 2026.
France: la croissance plus vive que prévu au deuxième trimestre
La croissance économique française a atteint 0,3% au deuxième trimestre, meilleure qu’anticipé malgré un environnement national et international très incertain, marqué par l’offensive protectionniste des Etats-Unis et un effort budgétaire important en France.Cette hausse modérée du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro est supérieure à la prévision de l’Institut national de la statistique français, qui anticipait une croissance de 0,2% après +0,1% au premier trimestre.”C’est vraiment une bonne nouvelle: 0,3%, ça veut dire que depuis le début de l’année, on a une croissance légèrement supérieure à 0,5%”, s’est réjoui le ministre français de l’Economie, Eric Lombard, sur la radio RTL, rappelant que le gouvernement visait 0,7% pour l’ensemble de 2025.Cela “montre bien, alors que les droits de douane s’appliquaient déjà, que (les entreprises) résistent à cette situation”, a-t-il estimé. Le président américain Donald Trump avait instauré en avril une surtaxe douanière de 10%, s’ajoutant à la moyenne de 4,8% de droits s’appliquant jusque-là sur la majorité des produits importés de l’UE. L’accord conclu dimanche soir entre Washington et l’Union européenne prévoit un taux généralisé de 15% à partir du 1er août, sauf exceptions. En France, cette décision inquiète fortement.La France s’en tire mieux que deux autres poids lourds européens, l’Allemagne et l’Italie, dont le PIB a baissé de 0,1% au deuxième trimestre, alors que la première économie de la zone euro espère se sortir de deux années de récession consécutives. A contre-courant, l’Espagne affiche un fort dynamisme (+0,7%). – “Bases fragiles” -Si en France la croissance a surpris positivement, sa composition est toutefois jugée inquiétante.Comme en début d’année, ce sont les stocks qui l’ont tirée au deuxième trimestre avec une contribution positive de 0,5 point. Les stocks représentent les biens produits mais pas encore vendus à la fin d’une période donnée. Dans le cas présent: des matériels aéronautiques et automobiles. Une hausse des stocks peut signifier qu’on fabrique en prévision d’un boum de la demande. Mais cela peut aussi vouloir dire que les produits fabriqués n’ont pas trouvé preneur.”Cela reste une croissance qui repose sur des bases très fragiles. La demande intérieure est quasi nulle et la production est trop dynamique par rapport à la demande domestique et extérieure”, a souligné Maxime Darmet, économiste senior chez Allianz Trade, interrogé par l’AFP. De fait, la demande intérieure finale hors stocks a stagné. Pilier traditionnel de la croissance, la consommation des ménages a légèrement rebondi, de 0,1% après un recul de 0,3% au premier trimestre, portée par une consommation accrue de produits alimentaires. “Ce redressement peut s’expliquer notamment du fait du positionnement des fêtes de Pâques fin avril et d’une météo favorable en avril et mai”, a expliqué l’Insee.Mais les ménages restent peu portés sur la dépense depuis la pandémie et très attentistes dans un environnement chahuté. Ils préfèrent alimenter leurs bas de laine: le taux d’épargne a atteint 18,8% en début d’année, le record hors période Covid.Les investissements se sont eux enfoncés dans le rouge (-0,3% après -0,1%), surtout chez les entreprises. – Incertitude budgétaire -Un grand facteur d’incertitude concerne le budget 2026, dont les grandes orientations ont été déclinées le 15 juillet par le Premier ministre français François Bayrou, avec l’objectif de ramener de 5,4% à 4,6% du PIB le déficit public de la France, le plus important de la zone euro. Les mesures prévoient un effort de 43,8 milliards d’euros, passant notamment par un gel des prestations sociales, des retraites et des dépenses budgétaires (hors Défense).L’effort budgétaire, qui passe dès cette année par des économies d’une cinquantaine de milliards d’euros, ne s’est pour l’instant pas traduit dans la consommation des administrations publiques au deuxième trimestre (+0,2%). La contribution du commerce extérieur à la croissance est restée négative, de -0,2 point, le léger rebond des exportations ayant été contrebalancé par une accélération des importations. Pour 2025, l’Insee table sur une croissance de 0,6%, sensiblement moins qu’en 2024 (1,1%). Selon Eric Lombard, qui reçoit mercredi au ministère les filières économiques affectées par l’accord commercial, celui-ci aura un impact “mesuré” sur l’économie française. Mais Maxime Darmet dit “craindre que la situation se complique au deuxième semestre” car “les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier sont très faibles”.
La Bourse de Paris stable, entre Fed et résultats d’entreprises
La Bourse de Paris évolue sans tendance notable mercredi, avant de connaître l’issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en digérant une série de publications de résultats d’entreprises.Vers 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,14%, en hausse de 12,51 points, à 7.869,87 points. La veille, l’indice parisien avait pris 0,72%.”L’attention des investisseurs se tourne vers (…) la Fed”, qui tient sa réunion de politique monétaire et doit présenter sa décision dans la soirée, commente John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion Private Bank.Son président, Jerome Powell, fait face à une pression croissante de Donald Trump pour baisser ses taux directeurs.Jerome Powell s’y refuse car il veut connaître avant les effets de la politique de droits de douane du président américain sur les prix dans la première économie mondiale.Autre point d’attention: la publication des chiffres du PIB du deuxième trimestre dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis, à 14H30.En France, la croissance économique a atteint 0,3% au deuxième trimestre, tirée par les stocks et un léger rebond de la consommation des ménages, selon les chiffres de l’Insee publiés mercredi.Côté obligataire, le rendement à dix ans de l’emprunt français atteignait 3,35%, contre 3,36% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,69%, contre 2,70%.Les investisseurs suivent aussi les publications de résultats d’entreprises, dont la cadence s’accélère cette semaine.Danone bonditLe géant de l’agroalimentaire français Danone bondissait de 6,60% à 70,74 euros vers 9H50 (heure locale) à la Bourse de Paris, suite à la publication de résultats meilleurs que prévu en termes de ventes au deuxième trimestre.Perte nette pour WordlineLe spécialiste des paiements électronique Worldline (-3,53% à 3,44 euros), qui a connu de nombreux déboires ces dernières années, a annoncé mercredi avoir essuyé une perte nette de 4,2 milliards d’euros au premier semestre en raison d’une dépréciation d’actifs.Nexans revoit ses objectifsNexans (+5,06% à 124,50 euros) a revu ses objectifs en hausse pour l’année 2025 avec un bénéfice d’exploitation (Ebtida ajusté) compris entre 810 et 860 millions d’euros, contre une fourchette estimée précédemment de 770 à 850 millions d’euros (hors cession de Lynxeo et changements futurs de périmètre).Hermès en baisseLe groupe de luxe Hermès (-3,57% à 2.293,00 euros) a annoncé mercredi un bénéfice net en baisse de 5% au premier semestre à 2,2 milliards d’euros, pénalisé par la contribution exceptionnelle des entreprises, mais ses ventes ont progressé de 7,1% à 8 milliards d’euros.Kering moins mauvais que prévuLe groupe de luxe Kering a vu son bénéfice plonger de 46% et ses ventes reculer nettement au premier semestre. Mais le chiffre d’affaires de sa marque phare Gucci est légèrement moins mauvais qu’attendu par les analystes, ce qui fait grimper le titre (+3,72% à 220,35 euros).
“Un marathon à la vitesse de la F1”: la Chine veut dépasser les Etats-Unis dans l’IA
Derrière les robots danseurs et les avatars futuristes, la Chine a envoyé un message clair lors de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai: elle a l’ambition de prendre le leadership du secteur, devant les Etats-Unis.L’avance américaine a été remise en question début 2025, avec la présentation par la start-up chinoise DeepSeek d’un robot conversationnel rivalisant avec les meilleurs modèles américains – pour un coût bien moindre.La Chine, les Etats-Unis et d’autres grandes économies sont “engagés dans un marathon à la vitesse de la F1″, résume Steven Hai, professeur en innovation technologique à l’Université Jiaotong-Liverpool de Xi’an.”Quel pays prendra l’avantage? Cela ne pourra être évalué que de manière dynamique, au fil du développement du secteur”, souligne-t-il. Les deux puissances dominent le secteur: seuls 10 à 15% des modèles développés récemment l’ont été sans leur participation, selon l’institut de recherche Epoch AI.Si des groupes américains comme Google ou OpenAI restent en tête, Epoch estime que 78% des modèles chinois sont jugés “à la pointe” de la technologie, contre 70% côté américain.L’objectif déclaré de Pékin est désormais de devenir d’ici 2030 le “centre mondial de l’innovation” en matière d’IA.”Avec son offre technologique solide et une Amérique davantage tournée vers elle-même, la question est de savoir si cette vision de Pékin parviendra à séduire à l’international”, juge Tom Nunlist, analyste du cabinet Trivium China.En mai, Brad Smith, président de Microsoft, avait affirmé devant le Sénat américain que le “facteur décisif” serait de savoir quelle technologie, chinoise ou américaine, sera “la plus largement adoptée dans le reste du monde”.- “Souveraineté dans l’IA” -L’avantage chinois est à la fois technologique et économique.”Une des grandes différences (avec les modèles américains), c’est que la plupart des modèles de pointe chinois sont poids libre et en code source ouvert”, a déclaré l’ex-PDG de Google, Eric Schmidt, lors de la conférence de Shanghai.Le poids libre (ou open weight) signifie la mise en accès libre aux paramètres de pondération – les critères qui définissent la manière dont un modèle fonctionne après sa mise au point.En clair, cela signifie que ces modèles peuvent être adaptés par d’autres pays à leurs propres besoins, souligne George Chen, du cabinet de conseil américain The Asia Group. “On voit déjà des pays comme la Mongolie, le Kazakhstan ou encore le Pakistan chercher à s’appuyer sur le modèle DeepSeek pour développer leurs propres outils”, souligne-t-il.Le relatif faible coût des technologies chinoises – logiciel mais aussi matériel, via des entreprises comme Huawei – pourrait séduire les pays en développement, ajoute M. Chen.Les Etats-Unis tentent ces dernières années de préserver leur avance en renforçant les restrictions sur l’exportation de puces de pointe vers la Chine. Mais cela pousse aussi les entreprises chinoises à exploiter des failles règlementaires pour accéder aux précieux circuits – par la contrebande ou des pratiques de contournement-, note le professeur Steven Hai.- Problèmes de confiance -Les firmes chinoises de l’IA doivent également faire face à la censure de l’Etat-parti chinois, qui génère “des problèmes globaux de confiance lors de l’utilisation de technologies chinoises”, note Tom Nunlist, de Trivium China.En juin, OpenAI avait accusé Zhipu -un autre acteur chinois de l’IA- d’entretenir des liens étroits avec les autorités chinoises.”L’objectif est d’ancrer ces systèmes et normes chinois dans les marchés émergents avant que les concurrents américains ou européens ne puissent le faire”, avait estimé OpenAI.Pour contrebalancer ces craintes, la Chine a cherché, lors de la conférence WAIC, à se présenter comme un acteur responsable.Le Premier ministre chinois Li Qiang s’est notamment engagé à partager la technologie avec d’autres nations, en particulier les pays en développement.Ces propos contrastent avec le plan d’action agressif sur l’IA lancé quelques jours plus tôt par le président américain Donald Trump, qui prévoit une faible régulation du domaine.Pékin a également dévoilé son propre plan d’action lors de la WAIC, à l’issue d’une réunion réunissant des délégués de dizaines de pays.Le Premier ministre chinois a notamment annoncé la création d’une organisation dédiée à la coopération internationale dans l’IA, qui serait dirigée par la Chine.Mais les détails de cette nouvelle organisation — y compris les membres éventuels — n’ont pas été précisés, malgré une demande transmise par l’AFP au ministère chinois des Affaires étrangères.Plusieurs délégués étrangers ont également déclaré ne pas avoir été informés de cette annonce au préalable.L’IA est encore à un stade balbutiant, écrit dans une note l’analyste Grace Shao, spécialiste de l’IA chinoise.”Il ne devrait tout simplement pas y avoir de conclusion définitive sur qui est ‘en train de gagner’ pour l’instant”.
Cinq produits concernés par les droits de douane du 1er août aux Etats-Unis
Annoncés en grande pompe puis mis en pause, les droits de douane que le président américain Donald Trump présente improprement comme “réciproques” devraient entrer en vigueur le 1er août, avec un impact attendu, à moyen terme sur les prix d’une large gamme de produits.Pour la quasi-totalité des économistes, il ne fait en effet aucun doute que les consommateurs américains devront acheter plus cher leurs produits préférés dans les mois à venir. Comme pour ces cinq produits.- Consoles de jeuLe deuxième trimestre avait marqué une période essentielle pour le fabricant japonais Nintendo, qui a annoncé le 2 avril le lancement de sa console Switch 2, le jour de l’annonce par le président Trump de ses surtaxes.Si le lancement début juin s’est fait durant la pause de 90 jours annoncée dans la foulée des droits de douane, leur entrée en vigueur le 1er août pourrait signifier une hausse des prix de la console, largement fabriquée au Vietnam, pays qui a accepté, dans un accord commercial, l’application de 20% de surtaxe sur ses produits par Washington. Vendue 450 dollars, la console pourrait augmenter de 75 à 100 dollars selon diverses estimations.Son concurrent japonais Sony a déjà augmenté les prix de sa console PS5, dans la foulée des annonces du 2 avril, et pourrait être tenté de recommencer, tout comme Microsoft avec sa Xbox Series.- Vêtements et chaussuresL’immense majorité des vêtements et chaussures vendus aux Etats-Unis ne sont pas fabriqués sur place mais proviennent, comme en Europe, du Vietnam, du Bangladesh ou, de plus en plus, de pays africains comme le Kenya ou le Lesotho. Autant de pays qui verront leurs biens surtaxés au 1er août.Outre le cas vietnamien, les produits provenant du Bangladesh sont pour l’heure concernés par une surtaxe de 35%, que Dacca espère ramener entre 15 et 20% avant leur entrée en vigueur, selon la presse locale. Quant au Lesotho, le choc pourrait être plus rude: sauf changement, ses produits devraient être confrontés à 50% de droits de douane.Selon l’Association américaine de l’habillement et de la chaussure, 20% des vêtements importés aux Etats-Unis viennent du Vietnam et 11% du Bangladesh. Le Budget Lab de l’université de Yale a estimé de son côté que le prix des vêtements devrait augmenter de 37% en moyenne.- CaféLes Américains sont, de très loin, les plus gros consommateurs de café au monde, en volume total. L’immense majorité est importée, selon l’Association nationale du café. Parmi les principaux pays d’importation: la Colombie, le Vietnam ou le Brésil.Le pays lusophone est d’ailleurs celui visé par l’une des plus fortes hausses de droits de douane appliqués à ses produits, soit 50%, en représailles selon Donald Trump à la “chasse aux sorcières” dont serait victime l’ex-président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d’Etat.La Colombie elle ne devrait pas connaître de hausse au-delà des 10% de base déjà appliqués sur l’ensemble des produits entrant aux Etats-Unis depuis début avril.- Lessive et produits d’entretienSi nombre de ces produits sont fabriqués aux Etats-Unis, ils le sont à partir d’ingrédients dont une part non négligeable est importée. Or, les groupes ne comptent pas absorber le surcoût induit par les droits de douane.C’est en tout cas le message du PDG du groupe Procter & Gamble, qui commercialise la lessive Ariel, les couches Pampers ou les rasoirs Gillette, entre autres. Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs mardi, en marge de la publication des résultats trimestriels du groupe, Jon Moeller, a prévenu que les consommateurs observeront durant l’été une hausse des prix sur les produits du groupe.- ChocolatS’ils ne sont pas les plus gros consommateurs au monde, par habitant, les Etats-Unis sont les premiers importateurs de chocolat, qui provient principalement de l’Equateur et de la Côte d’Ivoire, selon les données du ministère américain de l’Agriculture.Près de la moitié, soit 47%, des fèves de cacao importées aux Etats-Unis proviennent du pays ouest-africain, dont les produits devraient être taxés à hauteur de 21% à compter du 1er août. Si les industriels veulent se rabattre sur le beurre de cacao, indonésien ou malaisien, les droits de douane seront alors de 19% ou 25%.