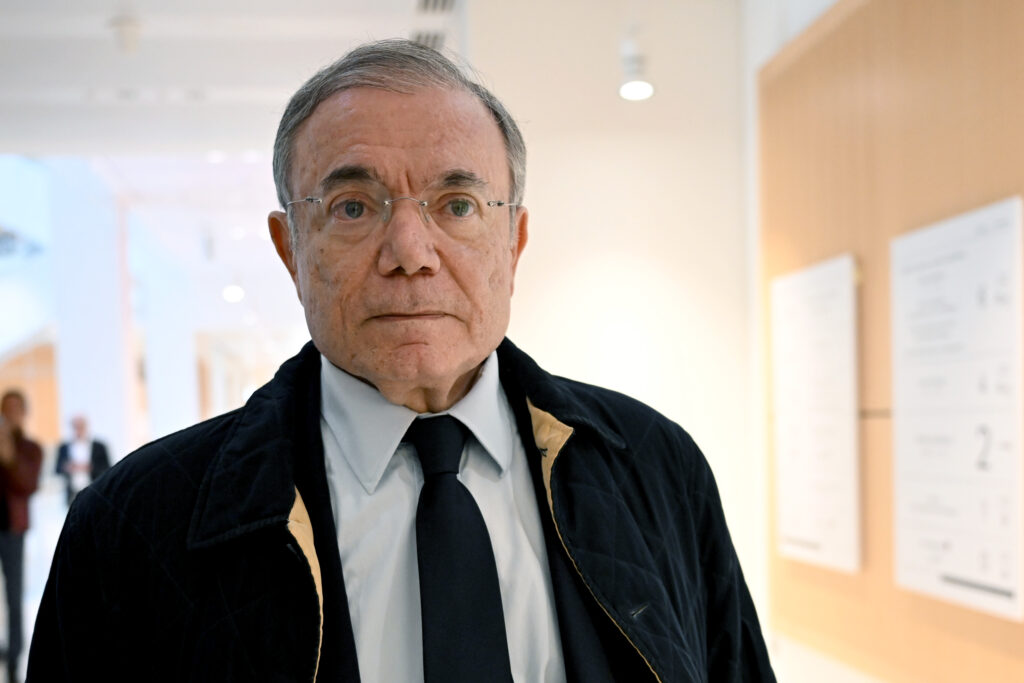“Sous mes ongles, ce n’est plus de la terre sacrée de Djenné, mais de la graisse de moteur”, soupire Oumar Cissé, nostalgique de sa vie d’avant.Pendant une dizaine d’années, il a été guide touristique à Djenné, ville du centre du Mali inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et célèbre mondialement pour sa majestueuse mosquée en banco, la plus grande construction en terre crue au monde.A cause de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région, M. Cissé, 47 ans, s’est résolu à abandonnerle tourisme pour gagner sa vie en conduisant une vieille moto-taxi dans les rues de Bamako, loin de l’argile de Djenné.Un métier qu’il dit exercer pour “nourrir” ses enfants, tout en souhaitant “qu’ils se souviennent que leur père était un guide, un homme de culture.””Comme guide, je pouvais te parler pendant trois heures de la lignée des familles, des minarets des mosquées, de pourquoi le banco ne tombe jamais malgré la pluie…”, se souvient-il.”Les touristes m’écoutaient avec des yeux ronds, ils notaient tout dans leurs petits carnets. J’avais l’impression d’être quelqu’un d’important”.- “Plus rien” -Depuis 2012, le Mali est plongé dans une profonde crise sécuritaire, alimentée par les attaques de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’Etat islamique, mais aussi par des groupes rebelles et des réseaux criminels.Le pays, qui compte quatre sites classés au patrimoine mondial et neuf éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, a longtemps été une destination majeure du tourisme culturel et patrimonial en Afrique de l’Ouest, avant quela situation sécuritaire n’en éloigne progressivement les visiteurs étrangers.Deux coups d’Etat en 2020 et 2021 menés par des militaires souverainistes, accusés de réduire l’espace civique et de réprimer les voix critiques et la récente dégradation encore des conditions sécuritaires, n’ont rien arrangé.La ville historique de Tombouctou, le tombeau des Askia à Gao, “vestige le plus important et le mieux conservé du puissant et riche empire Songhoy” selon l’Unesco, les remarquables habitats troglodytes des falaises du pays dogon, célèbre pour ses masques, ainsi que la spectaculaire traversée des boeufs à Diafarabé et Dialoubé, au coeur du delta du Niger, sont privés de touristes depuis près de 15 ans.”Les Occidentaux visitaient Tombouctou et les dunes de sables. Les princes arabes venaient chasser l’outarde, prenaient des permis et des guides. Plus rien”, regrette Sidy Kéita, directeur de Mali Tourisme, l’agence nationale de promotion touristique.La crise sécuritaire a entraîné “l’abandon de la destination, la fermeture de certains établissements de tourisme, la destruction d’autres, le licenciement ou la mise en chômage technique des agents”, explique sur son site Mali Tourisme.”De Ségou, au centre du Mali, à Tombouctou ou Gao au nord, beaucoup d’hôtels ont fermé, faute de clients. Pire, les promoteurs sont endettés”, dit à l’AFP un membre de l’Association malienne des hôteliers.”Depuis 2019, les recettes touristiques ont disparu de notre tableau des opérations”, confie un agent de la direction nationale du Tourisme et de l’Hôtellerie.Selon Mali Tourisme, “entre 200 et 300.000” touristes visitaient le Mali les meilleures années, générant de l’ordre de 183 millions d’euros par an.La contribution du secteur au PIB est passée de “près de 3%” à “seulement 1%”, déplorait en juillet le ministre malien du Tourisme, Mamou Daffé.- “L’espoir renaît” -Ces dernières années, le pays tente de relancer le secteur en mettant l’accent notamment sur le tourisme domestique comme alternative aux visiteurs étrangers.Des programmes incitant les fonctionnaires et le public à explorer leur pays, avec des circuits subventionnés à Bamako et dans les régions, ont par exemple été lancés.En décembre 2025, pour la première fois depuis plus d’une décennie, des touristes étrangers ont pu visiter Tombouctou, à l’occasion de la biennale artistique et culturelle organisée pour clôturer 2025, “année de la culture.””Des protocoles de sécurité stricts étaient en place, tous les étrangers devant être escortés par la police. Cela a permis aux agences de voyages locales d’attirer des voyageurs d’aussi loin que la Californie ou l’Allemagne pendant la biennale”, témoigne Ulf Laessing, directeur du programme Sahel de la Fondation Konrad Adenauer, qui était présent à la biennale. La compagnie privée Sky Mali a annoncé avoir transporté à Tombouctou “près de 1.000 passagers” pour la biennalealors que les chancelleries occidentales recommendent à leurs ressortissants de quitter le Mali et classent l’ensemble du pays en zone rouge. “L’espoir renaît… Nous avons reçu une centaine de touristes russes. C’est une clientèle nouvelle. Nous espérons qu’il y en aura d’autres, et que ce sera la relance de l’industrie du tourisme”, se réjouit Sidy Kéïta.Le régime militaire malien a tourné le dos à la France, l’ex-puissance coloniale, pour se rapprocher de la Russie, désormais son principal allié.