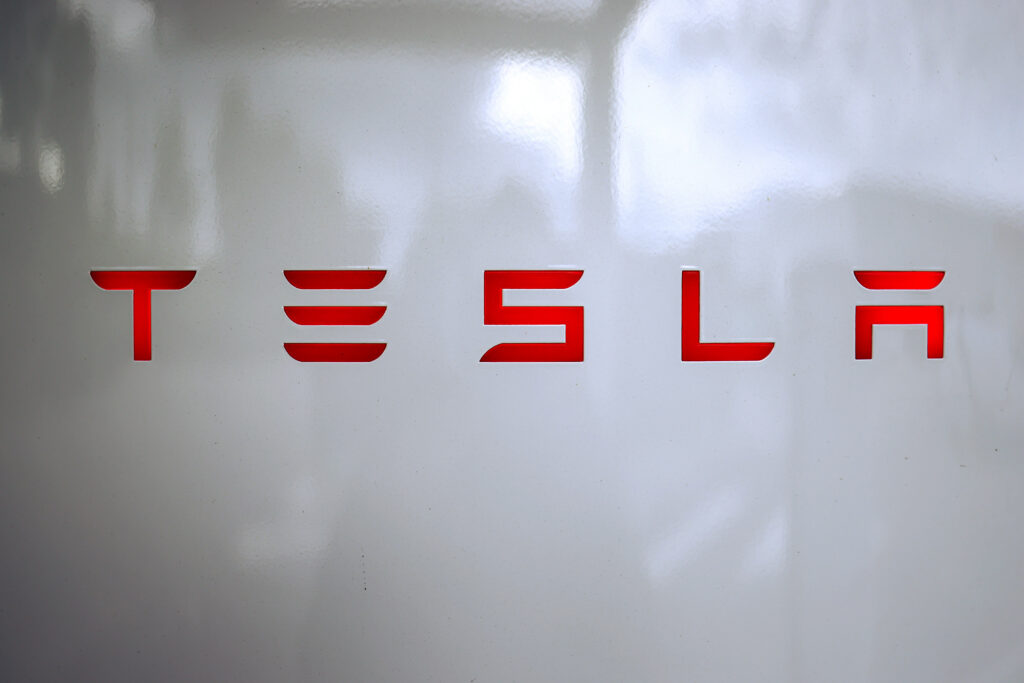Wall Street reprend son souffle après le recul de vendredi
La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, rattrapant l’essentiel de ses pertes de la semaine passée grâce à un rebond technique, les investisseurs choisissant de faire abstraction des incertitudes économiques entourant les droits de douane américains.Le Dow Jones a pris 1,34%, l’indice Nasdaq a gagné 1,95% et l’indice élargi S&P 500 a avancé de 1,47%, mettant un terme à une série de quatre séances consécutives de baisse.”Il y a eu des acheteurs à bon compte vendredi et dès que les marchés ont montré des signes de vie aujourd’hui, ils sont revenus à la charge parce que personne ne veut manquer un mouvement haussier”, commente auprès de l’AFP Steve Sosnick, d’Interactive Brokers.Selon lui, seul ce rebond technique peut expliquer cette progression de Wall Street, alors qu’aucune donnée économique d’ampleur n’a été publiée lundi et que “les prévisions de réduction des taux (d’intérêt de la Fed) n’ont pas changé de façon notable depuis vendredi”.Une très large majorité des analystes s’attend à une baisse d’un quart de point de pourcentage des taux de la banque centrale américaine lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre, selon l’outil de veille de CME.En cause: un rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis, publié vendredi, pire qu’attendu, avec notamment une révision en forte baisse des créations d’emplois, à des niveaux plus vus depuis la pandémie de Covid-19.”Compte tenu de l’ampleur des données qui ont été publiées vendredi et de la façon dont elles se répercutent sur le prix d’autres actifs financiers clés, il est assez surprenant de voir le marché boursier les ignorer complètement”, souligne Steve Sosnick.Mais “nous avons déjà vu des marchés boursiers réagir fortement à la moindre occasion d’achat”, selon l’analyste.Il relève aussi que “les traders et les investisseurs ont gagné beaucoup d’argent” en mettant de côté les craintes liées aux droits de douane.Les nouveaux droits de douane de Donald Trump qui devraient entrer en vigueur pour la plupart jeudi sont “quasiment définitifs” et ne devraient pas faire l’objet de négociations dans l’immédiat, a déclaré le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, dans une interview diffusée dimanche sur la chaîne CBS.Au tableau des valeurs, la marque de jeans American Eagle (+23,65% à 13,28 dollars) s’est envolée, profitant des commentaires élogieux de Donald Trump sur sa campagne publicitaire avec l’actrice Sydney Sweeney, qui crée la polémique.”Sydney Sweeney, une républicaine encartée, a la publicité la plus +BRULANTE+ du moment”, y écrit notamment Donald Trump. Selon lui, grâce à cette campagne, les jeans de la marque “se vendent comme des petits pains”.Le constructeur automobile Tesla (+2,19% à 309,26 dollars) a été recherché après avoir accordé à son patron Elon Musk 96 millions d’actions pour une valeur d’environ 29 milliards de dollars. L’énorme plan de rémunération de M. Musk fait toujours l’objet d’une bataille en justice.Le géant chinois des moteurs de recherche Baidu (+1,75% à 87,64 dollars) a profité de l’annonce du lancement de ses robotaxis sur l’application de covoiturage américaine Lyft en Allemagne et en Grande-Bretagne en 2026, sous réserve de l’approbation réglementaire.