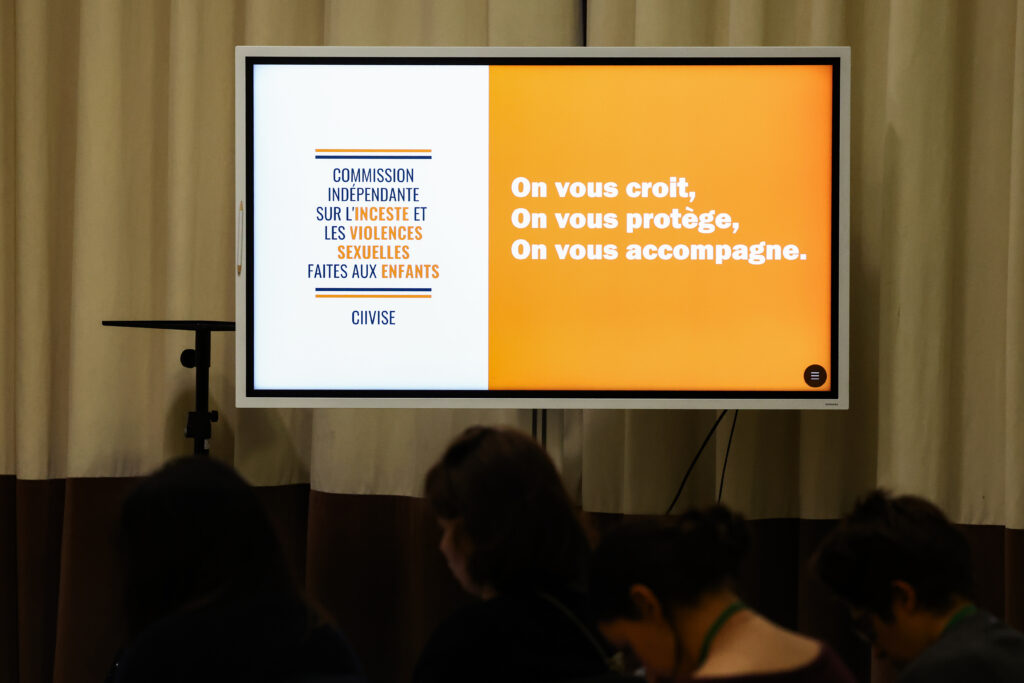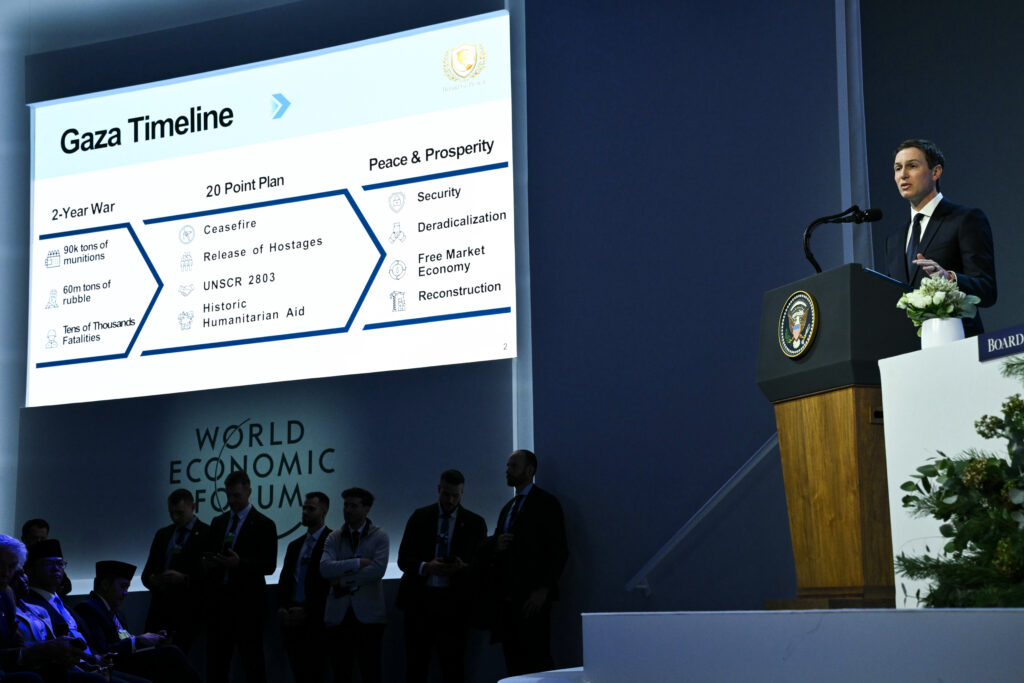La France intercepte à nouveau un pétrolier de la flotte fantôme russe
La Marine française a arraisonné jeudi en Méditerranée un pétrolier soupçonné d’appartenir à la flotte fantôme russe, quatre mois après l’interception en Atlantique d’un de ces navires qui permettent à Moscou d’exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales.Ce pétrolier, le Grinch, “sous sanctions internationales et suspecté d’arborer un faux pavillon”, a été intercepté “avec le concours de plusieurs de nos alliés”, a annoncé sur X le président Emmanuel Macron.Le chef de l’Etat français avait appelé début octobre les Européens à franchir un “pas” dans la “politique d’entrave” de ces navires, dont le commerce pétrolier permet à Moscou de financer “30 à 40%” de son effort de guerre contre l’Ukraine.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué l’arraisonnement du Grinch. “Merci à la France. C’est exactement le type de détermination nécessaire pour faire en sorte que le pétrole russe ne finance plus la guerre de la Russie”, a-t-il réagi sur X.L’opération s’est déroulée jeudi matin dans les eaux internationales de la mer d’Alboran, située entre l’Espagne et l’Afrique du Nord, à bord du “pétrolier-cargo Grinch en provenance de Mourmansk”, port arctique de la Mer de Barents.Elle “visait à vérifier la nationalité (du) navire”, dont “l’examen des documents a confirmé les doutes quant à la régularité du pavillon arboré”, ce qui a donné lieu à “un signalement au procureur de Marseille” et à l’ouverture d’une enquête, selon la préfecture maritime de Méditerranée.Le Grinch a été dérouté et “est actuellement escorté par des moyens de la Marine nationale vers un point de mouillage pour la poursuite des vérifications”, a-t-elle ajouté, précisant que l’opération a été menée “en coopération avec nos alliés dont le Royaume-Uni”.Le ministre britannique de la Défense John Healey a confirmé dans un communiqué que son pays avait fourni “un appui en matière de suivi et de surveillance”, notamment via le “déploiement du HMS Dagger pour surveiller le navire dans le détroit de Gibraltar”.Le pétrolier Grinch figure sous ce nom sur la liste des navires de la flotte fantôme russe placés sous sanctions par le Royaume-Uni, mais sous le nom de “Carl” sur la liste établie par l’Union européenne et les Etats-Unis.- Après le Boracay -Selon les sites marinetraffic et vesselfinder, spécialisés dans le suivi des navires, le pétrolier de 249 mètres de long faisait route vers l’est au moment de son arraisonnement, entre Almeria (Espagne) et Oran (Algérie), arborant le pavillon des Comores.Au moins deux hélicoptères et un navire de la Marine française ont été mobilisés, et une “équipe de visite” constituée de militaires cagoulés est montée à bord, selon des images diffusées par l’état-major des Armées.Pour Emmanuel Macron, cet arraisonnement, réalisé “dans le strict respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer”, démontre que la France est “déterminé(e) à faire respecter le droit international et à garantir l’efficacité des sanctions” contre la “flotte fantôme” russe, dont “les activités contribuent au financement de la guerre d’agression contre l’Ukraine”.”Aux côtés de nos alliés, nous intensifions notre riposte aux navires fantômes afin de tarir les fonds qui alimentent l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine”, a aussi souligné John Healey.Cette opération est la deuxième effectuée par la France après l’interception du Boracay. Ce dernier, qui figure lui aussi sur la liste des navires sanctionnés par l’Union européenne, avait été arraisonné fin septembre par les commandos marine français en Atlantique et détourné vers le port de Saint-Nazaire.Le pétrolier avait finalement pu reprendre la mer six jours tard. Son capitaine est convoqué en février à Brest afin d’être jugé pour “refus d’obtempérer”.L’arraisonnement du Grinch constitue une “bonne nouvelle”, a salué sur X Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Mais “il faut maintenant arriver à faire plus pour crédibiliser l’action: la saisie de la cargaison serait un défi juridique mais aurait un vrai poids stratégique”, a-t-il estimé.Quelque 598 navires soupçonnés de faire partie de la “flotte fantôme” font l’objet de sanctions de l’Union européenne.