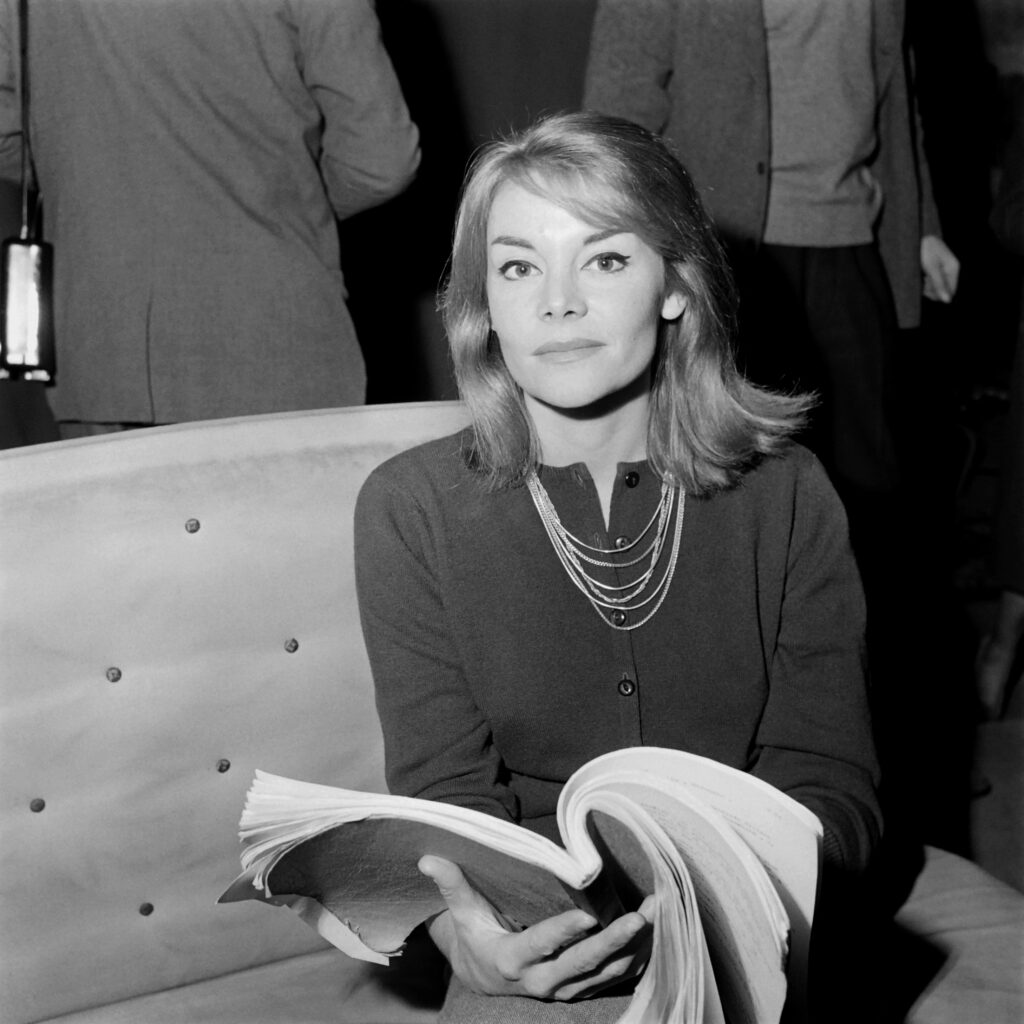Face à la crise que traverse le secteur automobile en Europe, l’Union européenne a renoncé mardi à imposer aux constructeurs de véhicules de passer au tout-électrique à partir de 2035, qui était une mesure environnementale phare.Les constructeurs pourront continuer à vendre une part limitée de voitures neuves équipées de moteurs thermiques ou hybrides, sous réserve de respecter de multiples conditions, notamment de compenser les émissions de CO2 qui découleront de ces “flexibilités”, a précisé la Commission européenne.En assouplissant l’objectif pour 2035, l’UE ne renonce pas à ses ambitions climatiques, mais adopte une approche “pragmatique” face aux difficultés rencontrées par l’industrie automobile, a défendu le commissaire européen Stéphane Séjourné, qui a piloté ce plan.”L’objectif reste le même, les flexibilités sont des réalités pragmatiques au vu de l’adhésion des consommateurs, de la difficulté des constructeurs à proposer sur le marché du 100% électrique pour 2035″, a-t-il affirmé, dans un entretien à l’AFP.Avec cette mesure, l’UE est sur le “bon chemin”, a approuvé le chancelier allemand Friedrich Merz.De son côté, le président français Emmanuel Macron a salué “l’équilibre de la proposition de la Commission”, qui tient compte de plusieurs demandes françaises. L’interdiction de vendre des voitures à moteur thermique ou hybride à partir de 2035 était une mesure emblématique du grand “Pacte vert européen”, pour aider l’UE à tenir son engagement d’atteindre la neutralité carbone en 2050.Mais l’Europe, face à la concurrence de la Chine et aux tensions commerciales avec les Etats-Unis, a déjà repoussé ou élagué ces derniers mois plusieurs mesures environnementales, dans un virage pro-business assumé. A la place de l’interdiction des voitures neuves à moteur thermique ou hybride qui était prévue, les constructeurs devront réduire de 90% les émissions de CO2 de leurs ventes par rapport aux niveaux de 2021, et compenser les 10% d’émissions restantes. Bruxelles assure ainsi que le secteur sera bien décarboné à 100% à l’horizon 2050.Les constructeurs du Vieux Continent réclamaient des “flexibilités” depuis des mois, alors qu’ils sont plombés par des ventes durablement atones, tandis que leurs rivaux chinois, dont BYD, voient leurs parts de marché s’envoler avec leurs modèles électriques aux prix attractifs.Pourtant, les réactions étaient mitigées mardi du côté des constructeurs.Si le groupe allemand Volkswagen a salué une décision “pragmatique” et “économique saine”, la principale fédération de l’industrie automobile allemande, VDA, a jugé le plan de Bruxelles “funeste” et assorti de trop d’obstacles pour être efficace.L’ONG Greenpeace a pourfendu une “mauvaise nouvelle”, tandis que pour le Réseau action climat, “il s’agit d’un recul aussi symbolique que mortifère pour l’industrie automobile européenne, ses emplois et le climat”.Ces assouplissements ont fait l’objet d’intenses tractations entre la Commission et les Etats membres, qui cherchaient à défendre au mieux les intérêts de leurs industries respectives, jusqu’au dernier moment.D’un côté, un bloc de pays dont l’Allemagne et l’Italie défendait à cor et à cri la “neutralité technologique”, c’est-à-dire le maintien à partir de 2035 des moteurs thermiques, en mettant en avant des technologies plus économes en CO2 (hybrides rechargeables, véhicules électriques équipés de prolongateurs d’autonomie…) et le recours aux carburants alternatifs.- Un soutien aux batteries -A l’inverse, France et Espagne appelaient l’UE à dévier le moins possible de l’objectif 2035, afin de ne pas saper les efforts de certains constructeurs pour se convertir au tout-électrique, et ne pas détruire la filière en pleine éclosion des batteries de voitures électriques.Pour répondre à ces craintes, la Commission a dévoilé mardi une série de mesures de soutien à l’électrification du secteur, passant par l’encouragement au “verdissement” des flottes d’entreprises et des prêts à taux zéro pour la production de batteries.M. Séjourné a également confirmé l’instauration d’une “préférence européenne” dans l’automobile, c’est-à-dire l’obligation pour les industriels bénéficiant de financements publics de se fournir en composants “made in Europe”.Une façon très concrète de soutenir toute la chaîne des équipementiers, fournisseurs et sous-traitants.Pour la France, cette mesure sur la préférence européenne “est une énorme victoire”, a estimé la ministre française de la Transition écologique Monique Barbut auprès de l’AFP.Celle-ci a cependant regretté la flexibilité accordée aux véhicules thermiques, à laquelle elle entend s’opposer lors des négociations qui vont s’ouvrir au sein des Vingt-Sept.Car ces propositions devront encore être approuvées par les Etats membres et le Parlement européen.Enfin, la Commission veut encourager le développement de petits véhicules électriques européens aux tarifs “abordables”.