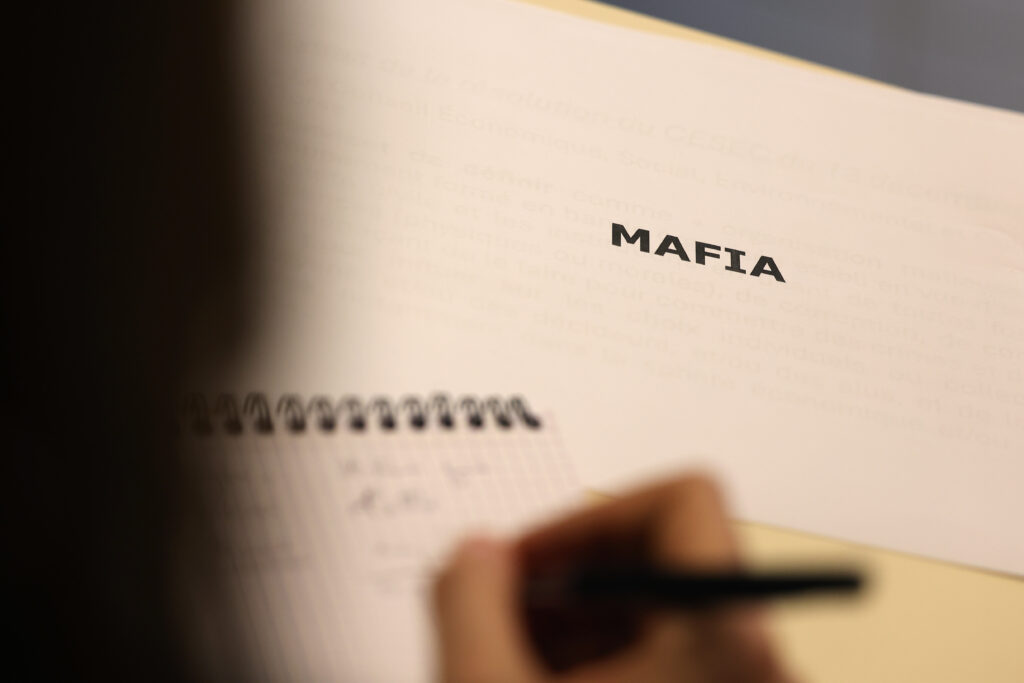Motard percuté sur l’A4: deux policiers condamnés à 3 ans de prison avec sursis
Deux policiers ont été reconnus coupables de violence volontaire aggravée et condamnés à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Créteil jeudi pour avoir volontairement percuté un motard avec leur voiture de service sur l’A4 en région parisienne.Le major de police, Eric B., 53 ans, et le gardien de la paix Nils P., 26 ans, ont également été condamnés à une interdiction d’exercer la profession de fonctionnaire de police pendant un an et de porter une arme pendant un an, avec exécution provisoire.C’est un jugement plus sévère que les réquisitions du parquet, qui avait demandé une peine de 18 mois de prison avec sursis, assortie d’une interdiction de porter une arme pendant un an et d’exercer toute fonction publique pendant deux ans, avec exécution provisoire.”Nous sommes particulièrement contents de cette décision qui montre l’évolution de la prise de conscience de la gravité des violences policières par la justice désormais fréquemment sanctionnée par l’éviction des auteurs de la police”, a commenté l’avocat du motard, Me Arié Alimi.Le 14 octobre, la voiture de service des deux policiers a été filmée par la caméra embarquée d’un véhicule situé en retrait, percutant le motard Hugo Van Rooij sur l’A4, au niveau de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Rapidement devenues virales, les images de la scène ont montré la voiture se déporter vers le motard tandis que le gardien de la paix sort son bras par la fenêtre en direction d’Hugo Van Rooij. Percutée, la moto guidonne avant de retrouver son équilibre alors que le véhicule sérigraphié s’éloigne.”C’est un traumatisme que mon cerveau ne sait pas comment traiter. Je rumine énormément. Je dors moins bien. J’ai du mal à me concentrer”, a témoigné Hugo Van Rooij, 37 ans.Tout au long des débats, le conducteur du véhicule Eric B. et son coéquipier Nils P., qui était passager, ont contesté le caractère intentionnel de la collision.A la barre, ils ont livré le même récit qu’aux enquêteurs de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN): malade le jour des faits, Nils P. a cédé sa place à son supérieur qui a pris le volant et enclenché les gyrophares pour rentrer au plus vite, en raison de son état de santé.”Je sais que la moto est là, j’estime mal sa vitesse et je pense pouvoir passer devant la moto (…) mais la moto va bien plus vite que ce que je pense”, a argué Eric B., reconnaissant “une faute de conduite” et un défaut de vigilance.Des explications rejetées par la cour.